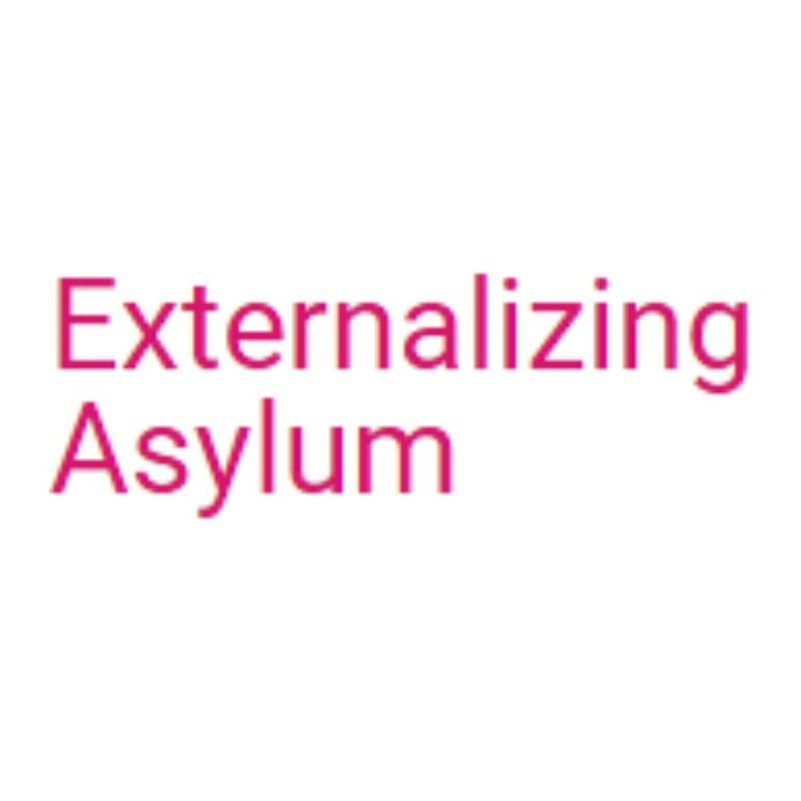Externalisation de la cruauté : la délocalisation de la gestion des migrations
Les États du Nord externalisent systématiquement le traitement des demandes d’asile et la détention vers des pays au bilan médiocre en matière de droits humains, versant des milliards à des régimes autoritaires pour intercepter, détenir et accueillir des réfugiés qui, autrement, auraient pu trouver la sécurité. Ce qui relevait autrefois de mesures exceptionnelles risque de devenir une pratique courante. Ces politiques violent le droit international, renforcent des dictatures et rendent la migration plus périlleuse. Alors que les États riches se dérobent à leurs obligations humanitaires, des personnes désespérées deviennent monnaie d’échange dans des accords transactionnels. La société civile, qui organise la résistance, se retrouve en retour visée par des mesures répressives. Une action urgente est nécessaire pour rétablir le droit d’asile et la dignité humaine.
Dans le cadre de la nouvelle politique de l’administration Trump, des milliers d’Afghans ayant fui vers les États-Unis après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 risquent d’être expulsés vers des pays qu’ils ne connaissent pas. En Europe, des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée risquent d’être détenus indéfiniment dans des centres de détention administrés par l’Italie en Albanie. Loin d’être des incidents isolés, il s’agit des conséquences d’un changement politique délibéré.
Les pays du Nord multiplient les moyens de renvoyer les migrants vers d’autres États. Les démocraties riches concluent des accords de plusieurs millions de dollars avec des régimes autoritaires, les rémunérant pour intercepter, détenir et accueillir des migrants et des réfugiés qui, autrement, auraient trouvé refuge sur leur territoire. Plutôt que de gérer eux-mêmes les arrivées et de traiter les demandes d’asile, ils délèguent ces responsabilités à d’autres. Ils transforment ainsi les arrivées irrégulières en un problème extérieur, tout en permettant aux dictateurs et aux seigneurs de guerre de monnayer leur coopération contre de l’argent et une relative impunité. Les personnes vulnérables en quête de protection sont instrumentalisées et exposées à la violence ainsi qu’à des graves violations des droits humains.
Ces accords enfreignent les principes fondamentaux du droit international, notamment le droit de demander l’asile et l’interdiction de renvoyer quiconque vers un lieu où sa sécurité est menacée. Ils instaurent en outre un système de protection pervers : une fois qu’un pays a été qualifié de « sûr » pour les expulsions, les gouvernements du Nord deviennent beaucoup moins enclins à critiquer son bilan en matière de droits humains.
Loin d’endiguer la migration, les accords d’externalisation la rendent plus meurtrière. Ils forcent des personnes désespérées à emprunter des itinéraires toujours plus dangereux et profitent aux réseaux criminels de passeurs, indifférents aux droits humains. Dans le même temps, les organisations de la société civile, les militants et les journalistes qui documentent ces échecs font face à une répression croissante.
Comment cela fonctionne
Les accords vont de traités formels à des ententes informelles, mais ils ont en commun le manque de transparence et d’obligation de rendre compte. Cela ouvre la voie aux abus et limite la capacité de la société civile à surveiller et à intervenir.
La pratique la plus répandue consiste à intercepter les migrants avant leur arrivée. L’Union européenne (UE) en a fait un procédé standard, dépensant des milliards pour transformer les pays non-membres de l’UE en zones tampons : elle finance leurs forces frontalières et leurs garde-côtes afin de stopper les migrants avant qu’ils n’atteignent son territoire.
Les États ont également de plus en plus recours au traitement offshore, qui consiste à transférer les demandeurs d’asile vers d’autres pays pour y voir leurs dossiers examinés. D’abord mise en place par l’Australie, cette approche est désormais reprise par de nombreux pays du Nord. Les personnes peuvent y être détenues pendant de longues périodes, privées d’assistance juridique et exposées à la violence ou à la torture dans des installations conçues davantage pour les contenir que pour les protéger.
Le précédent australien
L’Australie a été la première à externaliser la gestion des migrations en 2001, lorsqu’elle a signé des accords avec Nauru et la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour accueillir les migrants interceptés en mer. Dans le cadre de ce qui fut appelé la « solution Pacifique », elle a commencé à envoyer les demandeurs d’asile qui tentaient de gagner ses côtes vers des centres de détention installés dans les îles du Pacifique.
Le modèle australien a créé des précédents inquiétants : détention illimitée dans des conditions éprouvantes, refus d’accès à une représentation juridique et isolement géographique limitant le contrôle médiatique et la surveillance de la société civile. De nombreux détenus ont passé des années dans l’incertitude, développant de graves troubles de santé mentale. Malgré la condamnation internationale, le gouvernement a poursuivi sa politique, réduisant considérablement le nombre de demandeurs d’asile tentant de rejoindre l’Australie par bateau. Cela a servi de modèle pour d’autres pays.
Le centre régional de traitement de Manus, situé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a officiellement fermé en octobre 2017 après que la Cour suprême du pays l’a jugé inconstitutionnel. Pourtant, quelque 64 personnes soumises au traitement offshore y ont été laissées, sans véritable soutien ni perspective de réinstallation. En parallèle, le centre de Nauru reste opérationnel, avec plus d’une centaine de personnes détenues en janvier 2025 – le nombre le plus élevé de demandeurs d’asile détenus sur l’île depuis plus de dix ans.
Les accords de retour pour les non-ressortissants sont un autre outil utilisé par les États du Nord pour externaliser la gestion des migrations. Ils consistent à renvoyer les migrants vers des pays avec lesquels ils n’ont aucun lien, si ce n’est d’avoir transité par leur territoire. Ces accords contournent fréquemment les garanties d’une procédure régulière, permettant des expulsions rapides sans procédures juridiques appropriées ni examen individuel des besoins de protection. Un exemple est l’accord conclu en 1992 entre l’Espagne et le Maroc, qui permet à l’Espagne de renvoyer toute personne migrante entrée sur son territoire depuis le Maroc, qu’il s’agisse de citoyens marocains ou de ressortissants d’autres pays – principalement d’Afrique subsaharienne – ayant transité par le Maroc pour rejoindre l’Espagne.
Les expulsions massives vers des pays « consentants », comme celles menées par l’administration Trump, représentent l’aboutissement extrême de ces pratiques. Abandonnant toute prétention de protection, de telles politiques traitent les êtres humains comme des marchandises indésirables à expédier vers n’importe quel lieu acceptant un paiement. L’approche de Trump se caractérise notamment par le ciblage de résidents de longue date : plutôt que de viser uniquement les nouveaux arrivants, elle cherche à déraciner des individus et des familles qui ont passé des années à se construire une vie et une carrière, et qui ont tissé des liens communautaires solides.
Europe : de la réponse à la crise à une politique systématique
Lorsque, en 2015, un grand nombre de personnes fuyant les conflits et la répression en Afghanistan, en Irak et en Syrie ont atteint l’Europe, les systèmes d’asile ont été soumis à une pression exceptionnelle. Les États européens ont réagi en concluant des accords avec leurs homologues du Sud.
L’UE a signé son premier accord majeur sur le contrôle des migrations avec la Libye en 2015. Cet accord prévoit que l’UE fournisse des financements et des formations aux garde-côtes libyens afin que ceux-ci interceptent les migrants en mer avant qu’ils n’atteignent les eaux territoriales de l’UE. Il a ainsi établi un modèle d’externalisation du contrôle des frontières vers des pays au bilan médiocre en matière de droits humains, autorisant des refoulements systématiques vers la Libye malgré des preuves bien documentées de centres de détention inhumains, d’esclavage et de torture. L’accord a créé une politique de confinement qui contourne les obligations de l’UE en vertu du droit international des réfugiés, en garantissant que les demandeurs d’asile n’atteignent jamais le territoire européen pour demander protection.
L’accord conclu en 2016 entre l’UE et la Turquie a étendu ce dispositif : toute personne arrivant illégalement en Grèce devait être immédiatement renvoyée en Turquie. En contrepartie, l’UE s’est engagée à fournir 6 milliards d’euros (environ 6,5 milliards de dollars américains) pour soi-disant améliorer la situation humanitaire des réfugiés en Turquie et a promis une libéralisation des visas pour les citoyens turcs – une promesse qui n’a jamais été tenue. Depuis lors, le soutien financier de l’UE a été renouvelé à plusieurs reprises, dépassant désormais les 10 milliards d’euros (environ 10,8 milliards de dollars américains). Le gouvernement turc, profondément répressif, a utilisé cet accord pour obtenir de nouvelles concessions, autorisant parfois les migrants à franchir ses frontières afin de faire pression sur l’Europe.
D’autres accords ont suivi avec des pays servant de voies de transit vers la Méditerranée et l’Europe, notamment le Maroc et la Tunisie en 2023, l’Égypte en 2024, le Liban en 2024 et la Mauritanie en 2024. L’UE a versé des milliards d’euros pour former le personnel chargé de la sécurité des frontières et les garde-côtes, construire des centres de traitement des migrations et mener des patrouilles maritimes et aériennes afin d’intercepter les embarcations avant qu’elles n’atteignent le continent.
La volonté de financer ces partenariats révèle à quel point le contrôle des migrations s’est éloigné de l’engagement supposé de l’UE en faveur des droits humains et de la gouvernance démocratique. L’accord avec la Tunisie est emblématique : l’UE a soutenu le gouvernement du président Kais Saied malgré l’emprisonnement systématique de militants de la société civile, de journalistes et d’opposants politiques, renforçant ainsi un gouvernement qui a attisé un dangereux sentiment anti-migrants menant à de violentes attaques contre les migrants et les réfugiés africains subsahariens.
Le Pacte européen sur la migration et l’asile, adopté en 2024, a créé ce qu’il appelle des « centres de retour sécurisés » afin d’accélérer les expulsions.
La normalisation de l’externalisation s’est accentuée avec la montée de l’extrême droite en Europe. Le projet Rwanda du Royaume-Uni, bien qu’annulé à la suite d’un changement de gouvernement et après des années de contestations juridiques et de controverses politiques, a légitimé l’idée du traitement offshore en démontrant que même les démocraties établies étaient prêtes à envoyer des demandeurs d’asile vers des pays lointains où les droits humains sont bafoués. Ce projet aurait dirigé les demandeurs d’asile vers l’autoritaire Rwanda pour le traitement de leur demande, les plaçant en détention pour une durée indéterminée à des milliers de kilomètres de toute aide juridique ou réseau de défense.
L’hostilité envers les personnes migrantes et réfugiées légitimée par ce projet n’a cessé de s’intensifier, les groupes d’extrême droite mobilisant jusqu’à 150 000 personnes lors d’une manifestation anti-migrants à Londres en septembre.
Le gouvernement nationaliste de droite italien a tenté de mettre en place un programme similaire pour traiter les demandes d’asile en Albanie, dans des installations mêlant centres de traitement et centres de détention, mais le programme a fait l’objet de contestations juridiques et les tribunaux ont rendu des décisions défavorables au gouvernement. Les Pays-Bas étudient la possibilité de conclure des accords d’expulsion avec l’Ouganda, pays répressif, qui servirait de centre de transit pour les demandeurs d’asile africains dont la demande a été rejetée et en attente de retour dans leur pays d’origine, en échange d’une compensation financière.
Parallèlement, plusieurs États européens durcissent leurs politiques afin de refuser les demandeurs d’asile à leurs frontières via des procédures accélérées limitant les garanties d’une procédure régulière. Ce qui était autrefois politiquement impensable est devenu un discours et une pratique courants.
Depuis longtemps, la société civile européenne s’oppose à ces tendances régressives. Des groupes de défense des droits ont contesté les accords de l’UE avec la Libye et la Turquie devant la Cour européenne des droits de l’homme et des tribunaux nationaux. Des réseaux d’activistes coordonnent en temps réel les opérations de sauvetage des migrants en mer, tandis que certaines organisations mènent directement des opérations de recherche et de sauvetage, contrant les efforts d’interception financés par l’UE. Des bénévoles de la société civile fournissent une aide humanitaire dans les centres d’accueil et les camps de réfugiés. La société civile a dénoncé les violations systématiques des droits humains dans les centres de détention financés par l’UE et a souligné le caractère illégal des opérations de refoulement.
Mais ces actions entraînent des réactions négatives. Plusieurs pays de l’UE ont criminalisé les opérations de recherche et de sauvetage, harcelant les organisations, saisissant leurs biens et poursuivant leur personnel. Les gouvernements ont refusé aux journalistes et aux chercheurs l’accès aux centres de détention et de traitement, et ont poursuivi les travailleurs humanitaires en vertu des lois anti-trafic pour avoir fourni une assistance aux migrants. Malgré les restrictions, les réseaux de défense continuent de dénoncer le coût humain de ces politiques.
Les États-Unis : une externalisation à l’échelle industrielle
Les États-Unis ont une longue histoire d’externalisation du traitement des demandes d’asile, mais ces pratiques ont atteint des niveaux sans précédent sous l’administration Trump, qui a mis en place un système d’expulsions massives vers des pays avec lesquels les personnes expulsées n’ont aucun lien.
Depuis son entrée en fonction en janvier 2025, Trump a invoqué une disposition obscure de la loi américaine sur l’immigration pour expulser les immigrants sans papiers. Cette approche consiste à offrir des incitations financières à d’autres États, principalement dans les pays du Sud, ou à exercer des pressions diplomatiques pour les contraindre à accepter les personnes expulsées des États-Unis. Une douzaine d’États ont accepté de tels accords, notamment le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Paraguay, ainsi que des pays plus éloignés comme l’Eswatini, le Kosovo, le Rwanda, le Soudan du Sud et l’Ouganda. L’ampleur géographique de ces accords montre clairement que cette politique n’a rien à voir avec les routes de transit ; il s’agit purement et simplement de déterminer quels sont les gouvernements disposés à recevoir des financements en échange de l’accueil de personnes que les États-Unis cherchent à écarter.
L’administration Trump est prête à expulser des personnes vers des zones de guerre et des États autoritaires, voire directement vers des prisons. Dans le cadre de son programme d’expulsion élargi, elle a accepté de verser 6 millions de dollars au Salvador pour accueillir des expulsés vénézuéliens dans son Centre de détention pour terroristes (CECOT), une prison surpeuplée et tristement célèbre pour ses violations des droits humains. En mars, le gouvernement américain a accusé 238 Vénézuéliens d’appartenir à des gangs afin de justifier leur expulsion accélérée vers le Salvador. Après avoir été détenus sur la base de simples tatouages ou de choix vestimentaires, les déportés ont été envoyés au CECOT, avant d’être renvoyés au Venezuela en juillet dans le cadre d’un échange de prisonniers, soulevant de nouvelles questions sur l’utilisation des migrants comme monnaie d’échange diplomatique.
En août, le Rwanda a accueilli ses sept premiers déportés dans le cadre du programme de Trump. À peu près au même moment, l’Ouganda a signé un accord officiel avec le gouvernement américain et subit désormais des pressions pour accepter des déportés de haut rang tels que Kilmar Ábrego García, un résident du Maryland renvoyé aux États-Unis depuis le CECOT en juin.
Il s’agit clairement d’arrangements transactionnels. Les États sont récompensés par des paiements directs, des concessions commerciales, un allègement de sanctions et divers avantages diplomatiques. L’accord conclu avec l’Ouganda est intervenu alors que des sanctions américaines visaient certains responsables gouvernementaux, ce qui laisse penser que le pays a pu échanger l’acceptation de migrants contre une amélioration de ses relations diplomatiques et un allègement potentiel des sanctions. Quant à l’accord avec le Rwanda, il a coïncidé avec les pourparlers menés par les États-Unis avec la République démocratique du Congo au sujet de son conflit, ce qui montre que l’accord d’expulsion a servi de levier pour obtenir une coopération dans des négociations diplomatiques sans rapport direct.
L’approche de Trump dépasse les expulsions et inclut des interdictions de voyager étendues. En juin, le gouvernement a annoncé des restrictions d’entrée pour les ressortissants de 19 pays, et des notes internes ont révélé l’intention d’en ajouter 36 autres, principalement en Afrique, si ces pays ne satisfont pas aux exigences américaines en matière de contrôle et de coopération concernant les expulsions. Le département d’État a indiqué que la volonté d’un État d’accepter des ressortissants expulsés des États-Unis influencera ces décisions.
Résistance de la société civile
La stratégie de Trump, qui consiste à cibler les migrants établis, a suscité des réactions défensives sans précédent de la part des communautés locales, qui ont vu leurs voisins, collègues, amis ou membres de leur congrégation arrêtés. Partout aux États-Unis, les habitants se sont mobilisés au-delà des clivages politiques traditionnels : des enseignants ont protégé les familles de leurs élèves, des employeurs ont refusé de coopérer aux raids, des chefs religieux ont offert l’asile et des quartiers ont mis en place des réseaux d’entraide et des systèmes d’alerte précoce. Ces mobilisations traduisent la compréhension que les expulsions ne sont pas de simples mesures politiques, mais des attaques directes contre le tissu social.
Face à l’intensification des raids menés par l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) pour arrêter les migrants, avec un objectif de 3 000 arrestations par jour, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes des États-Unis. La résistance a été particulièrement vive dans les villes sanctuaires – des juridictions qui limitent la coopération avec les autorités fédérales en matière d’immigration et empêchent la police locale d’appliquer la législation migratoire – telles que Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco. Ces villes ont été les principales cibles des opérations fédérales visant à arrêter les migrants, notamment « Patriot 2.0 » à Boston et « Midway Blitz » à Chicago, entraînant des recours juridiques des autorités locales et des mobilisations massives de leurs habitants cherchant à défendre leurs voisins.
Le militantisme a dépassé le cadre des manifestations de rue pour cibler l’ensemble de l’infrastructure chargée des expulsions. Les raids de l’ICE sur les lieux de rassemblement des travailleurs journaliers, tels que les parkings de Home Depot ou des sites de production comme les usines de confection, ont déclenché des protestations, les manifestants affrontant les agents et tentant de bloquer les véhicules d’expulsion. Ces affrontements ont parfois dégénéré, les agents utilisant des fumigènes pour disperser la foule. L’ampleur de la résistance a conduit l’administration Trump à déployer 4 000 soldats de la garde nationale et 700 marines à Los Angeles, une intervention militaire fédérale sans précédent en réponse à des manifestations civiles.
Des manifestations ont également eu lieu dans des aéroports du Connecticut, du Maryland et d’autres États pour dénoncer les vols d’expulsion. Des campagnes de boycott ont visé Avelo Airlines, première compagnie aérienne commerciale à signer un contrat avec l’ICE pour assurer ces vols. Sous la pression des activistes, l’ICE a dû transférer ses vols d’expulsion du Massachusetts vers le New Hampshire après des mobilisations contre Signature Aviation, une société de logistique qui assure les vols d’expulsion.
D’autres actions ont été menées, notamment des manifestations devant les centres de détention de l’ICE et lors d’événements de recrutement de l’ICE. Dans l’université de Cal Poly Pomona, des étudiants ont ainsi contraint l’ICE à reporter un salon de l’emploi auxquels participaient des recruteurs de l’ICE, et à l’université de New York, une pétition a entraîné l’annulation de sessions de recrutement.
Les militants ont aussi lancé des campagnes de responsabilisation concernant les entreprises profitant des expulsions, en interpellant notamment Bill Gates au sujet de ses investissements dans Signature Aviation.
Restaurer l’humanité dans la politique migratoire
La trajectoire actuelle est inhumaine et insoutenable. Comme le rappelle l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, toute personne a le droit de demander l’asile. Pour exercer ce droit, il faut pouvoir quitter son pays et rejoindre un lieu sûr. Lorsque les États bloquent l’accès ou renvoient des personnes vers le danger, ils violent leurs obligations en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du droit international coutumier.
En externalisant la gestion des migrations, les États du Nord – se réclamant pourtant de la démocratie et des droits – se soustraient à leurs obligations internationales et renforcent les régimes autoritaires. En déclarant certains pays « sûrs » pour les migrants et en fournissant des ressources à des gouvernements autoritaires, ils consolident leurs capacités répressives.
Loin de freiner les migrations, ces politiques les rendent plus dangereuses : les personnes désespérées empruntent des itinéraires toujours plus risqués pour atteindre leur destination, tout en affrontant une xénophobie et un racisme désormais banalisés.
Dans tous les pays, la société civile s’est élevée contre la rhétorique et les politiques anti-migrants, dénonçant l’instrumentalisation des personnes migrantes et réfugiées comme boucs émissaires au lieu de s’attaquer aux causes économiques et politiques profondes.
Plutôt que de rejeter la responsabilité des problèmes nationaux sur les migrants, les États du Nord doivent ouvrir des voies sûres et légales pour la migration et l’intégration, notamment par le biais de visas humanitaires, de programmes de regroupement familial et de programmes de parrainage qui garantissent la protection de ceux qui en ont besoin. La récente décision de l’Espagne d’accorder un statut légal à 900 000 migrants en situation irrégulière démontre qu’une politique d’intégration progressiste est possible.
Les États du Nord doivent respecter pleinement les obligations juridiques et humanitaires qui constituent le socle de la civilisation. Le coût de l’inaction dépasse les drames individuels : il se traduit par l’érosion du droit international, le renforcement des régimes autoritaires et l’abandon de notre humanité commune.
NOS APPELS À L’ACTION
-
Les États du Nord doivent suspendre tous les accords de gestion offshore des migrations, cesser de financer les opérations d’interception et mettre fin aux expulsions vers des pays dangereux ou sans lien avec les personnes concernées.
-
La société civile doit intensifier la documentation des violations des droits des migrants, multiplier les recours juridiques contre les vols d’expulsion et les centres de détention, et développer des réseaux transnationaux pour dénoncer le coût humain de ces politiques.
-
Les organismes internationaux de défense des droits humains doivent mettre en place des mécanismes d’enquête sur l’externalisation de la gestion des migrations, émettre des avis juridiques contraignants et saisir les tribunaux internationaux face aux violations systématiques de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
Pour tout entretien ou information complémentaire, veuillez contacter research@civicus.org
Photo de couverture par Leonardo Fernandez Viloria/Reuters via Gallo Images