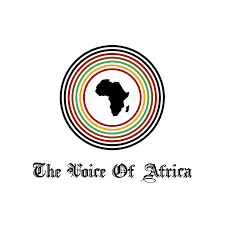Soulèvement au Togo : les revendications pour la démocratie se ravivent
La jeunesse togolaise a participé à des manifestations sans précédent contre les manœuvres constitutionnelles du président Faure Gnassingbé pour prolonger le régime dynastique de sa famille au pouvoir depuis 58 ans. L’arrestation du rappeur Aamron a déclenché le Mouvement du 6 juin (M66), mobilisant une génération qui n’a jamais connu la démocratie mais refuse de se soumettre au contrôle autoritaire. Malgré une répression brutale, la campagne menée par la jeunesse s’est transformée en un mouvement civique plus large, exigeant un véritable changement démocratique. La pression internationale et l’intervention régionale pourraient s’avérer cruciales pour déterminer si ces manifestations marquent le début d’une transition démocratique au Togo ou un nouvel épisode de répression de la dissidence.
Fin juin, des milliers de personnes ont envahi les rues de Lomé, la capitale du Togo, posant à la dynastie au pouvoir son plus grand défi depuis des décennies. Le déclencheur a été la transition controversée du président Faure Gnassingbé vers sa nouvelle fonction de président du Conseil des ministres le 3 mai, à la suite d’amendements constitutionnels adoptés en 2024. Cette manœuvre constitutionnelle représente le dernier épisode d’une saga familiale de 58 ans qui a commencé lorsque le père de Faure a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 1967. Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005.
Les manifestations les plus récentes ont été menées en grande partie par des jeunes qui n’ont jamais connu d’autres dirigeants que les Gnassingbé. Élevés dans l’espoir d’une démocratie multipartite, ils ont été témoins de fraudes électorales systématiques visant à maintenir au pouvoir un gouvernement totalement sourd à leurs besoins. Ils établissent un lien entre leurs difficultés quotidiennes liées au chômage, aux coupures d’électricité et aux infrastructures délabrées, et le déni prolongé de leurs libertés démocratiques. L’arrestation et les accusations de tortures du rappeur et TikToker populaire Aamron ont cristallisé le mécontentement, transformant la frustration latente en résistance organisée.
Soixante ans de règne dynastique
Après le coup d’État qui l’a porté au pouvoir, Gnassingbé Eyadéma a dirigé pendant 25 ans un État à parti unique, avec son Rassemblement du peuple togolais (RPT) comme seule organisation politique légale. Des cérémonies de vote rituelles donnaient au régime autoritaire une façade de légitimité. Cela a atteint des sommets absurdes en 1986, lorsque Eyadéma a été réélu avec près de 100% des voix et un taux de participation invraisemblable de 99%.
Le passage à une démocratie multipartite nominale en 1992 n’a pas changé grand-chose. Si les partis d’opposition ont été autorisés à se former, ils ont été confrontés à des obstacles systématiques qui ont rendu impossible toute concurrence équitable. Les élections étaient des mascarades dont les résultats étaient prédéterminés : en 1993, Eyadéma a revendiqué plus de 96% des voix, avec des résultats incohérents révélant une manipulation évidente.
À mesure que les forces d’opposition se consolidaient, Gnassingbé père a été contraint de réduire ses marges de victoire proclamées pour conserver une certaine crédibilité. En 2003, face à l’Union des forces pour le changement (UFC), il a revendiqué un score plus modeste de 57%, bien que les décomptes de l’opposition suggéraient qu’il n’avait recueilli que 10% des voix.
La mort d’Eyadéma en 2005 n’a apporté aucun changement démocratique. L’armée a nommé Faure comme successeur, malgré la constitution qui imposait l’organisation immédiate d’élections. Sous la pression internationale, un scrutin a été organisé à la hâte en avril, mais il a suivi le même scénario de violences, de fraudes et de répression. Les résultats officiels ont donné 60% des voix au fils Gnassingbé, inaugurant une tendance qui se répétera en 2010, 2015 et 2020.
La manœuvre constitutionnelle de cette année a marqué l’aboutissement de plusieurs années de planification minutieuse. Jusqu’à récemment, le système politique togolais reposait largement sur le pouvoir présidentiel. En 2019, apparemment en réponse aux pressions de la société civile, Gnassingbé a modifié la Constitution pour rétablir la limite de deux mandats présidentiels, supprimée par son père en 2002. Cependant, cette réforme en apparence démocratique contenait une clause dérogatoire : les limites ne s’appliqueraient pas rétroactivement, permettant à Gnassingbé d’exercer deux mandats supplémentaires au-delà de ceux déjà accomplis.
Les modifications constitutionnelles de mars 2024 ont parachevé ce plan : le Togo est passé à un système parlementaire avec un président du Conseil des ministres puissant, élu par l’Assemblée nationale plutôt que par le vote populaire. Cela a éliminé à la fois la limitation du nombre de mandats et la possibilité d’une défaite électorale, puisque la nouvelle fonction peut être prolongée indéfiniment à condition que le parti au pouvoir conserve sa majorité parlementaire, ce qui est facile à réaliser étant donné son contrôle sur le processus électoral.
Répression systématique
Le régime contrôle tous les leviers du pouvoir. La commission électorale, censée être indépendante, est composée de fidèles : en 2020, seuls deux de ses 19 membres n’étaient pas affiliés au parti de Gnassingbé, l’Union pour la République (UNIR). La Cour constitutionnelle, chargée de valider les résultats des élections, est également compromise, ce qui garantit que les recours juridiques contre les élections frauduleuses soient systématiquement rejetés. Les circonscriptions électorales sont redécoupées de manière à favoriser la base électorale du parti au pouvoir dans le nord du pays. Les forces de sécurité sont dominées par les membres du groupe ethnique de Gnassingbé, tandis que le régime s’appuie fortement sur des réseaux de clientélisme ; l’adhésion au parti offrant un accès à des emplois publics et à des contrats gouvernementaux.
Ce mécanisme de contrôle s’est perfectionné au fil des cycles de protestations répétés depuis deux décennies. Les manifestations de 2005 qui ont suivi l’arrivée au pouvoir de Gnassingbé ont été réprimées avec une extrême violence. Les forces de sécurité ont tué entre 400 et 500 manifestants qui réclamaient de nouvelles élections. Une nouvelle vague de manifestations à la suite des élections frauduleuses de 2010 a été accueillie par des tirs de gaz lacrymogènes, des passages à tabac et des arrestations arbitraires de la part des forces de sécurité. Les manifestations de 2012 et 2013, menées par la coalition Save Togo, regroupant des partis d’opposition et des groupes de la société civile, ont contraint le gouvernement à reporter les élections législatives, mais ont également été marquées par la mort suspecte en détention du leader de l’opposition Étienne Yakanou. Les groupes de la société civile ont accusé le gouvernement de l’avoir délibérément tué en lui refusant des soins médicaux.
Les manifestants ont été de nouveau confrontés à une réponse violente lorsqu’ils ont réclamé une réforme électorale et la limitation du nombre de mandats en 2014 et 2015. Le parti au pouvoir a été confronté à une contestation plus soutenue lors des manifestations de 2017 et 2018, lorsque des foules sont descendues dans la rue pour réclamer la limitation du nombre de mandats présidentiels, ce qui aurait mis fin au règne de Gnassingbé en 2020. La réponse du gouvernement a été particulièrement brutale : les forces de sécurité ont tiré à balles réelles, tuant au moins 16 personnes.
En 2020, le gouvernement avait mis au point des tactiques de répression préventive, imposant des interdictions de manifester et encerclant les domiciles des leaders de l’opposition afin d’empêcher les manifestations avant même qu’elles ne commencent. En 2024, il a suspendu les médias et arrêté préventivement des membres de l’opposition. Mais la résistance n’a pas faibli, contraignant le régime à prendre des mesures désespérées telles que la détention psychiatrique d’artistes ou encore l’émission de mandats d’arrêt internationaux contre des militants de la diaspora.
Le gouvernement a également mis au point des mécanismes sophistiqués de contrôle de l’information. Les journalistes sont régulièrement victimes de harcèlement. Récemment, la correspondante française Flore Monteau a été détenue et contrainte d’effacer les vidéos des manifestations, tandis que le rédacteur en chef de Togoscoop, Albert Agbeko, a été interrogé et on l’a obligé à supprimer des photos qu’il avait prises lors d’un reportage sur l’inscription des électeurs. Le gouvernement suspend régulièrement les médias internationaux, interdisant récemment France 24 et RFI pendant trois mois pour avoir prétendument diffusé des « propos inexacts et tendancieux » sur les manifestations. Les lois pénales sur la diffamation et la répression numérique, notamment l’utilisation de logiciels espions sur les téléphones des journalistes, se combinent pour faire taire les voix critiques.
Les coupures d’Internet sont devenues courantes lors des manifestations. Elles ont été utilisées pour la première fois de manière systématique lors des manifestations de 2017 à 2018 et se sont poursuivies lors des troubles récents. Le gouvernement bloque les principales plateformes de réseaux sociaux, notamment Facebook, Signal, Telegram et YouTube, conscient de leur rôle crucial dans l’organisation des manifestations. Il utilise des trolls pour manipuler l’engagement sur les réseaux sociaux et discréditer les organisations de défense des droits humains en ligne.
M66 et la dernière vague de protestations
La dernière vague de protestations a commencé lorsque la police a arrêté Aamron pour avoir publié une vidéo appelant la population à descendre dans la rue le jour de l’anniversaire de Gnassingbé, le 6 juin. Sa détention a déclenché une frustration latente chez les jeunes ; ils ont interprété ces tentatives pour le faire taire comme le symbole de leur propre impossibilité de s’exprimer. Cela a donné naissance au Mouvement du 6 juin (M66), dirigé par de jeunes artistes, des blogueurs, des activistes de la diaspora et des personnalités de la société civile qui s’appuient fortement sur les réseaux sociaux pour coordonner les manifestations et contourner les canaux contrôlés par l’État.
La première manifestation du M66 a eu lieu le jour de l’anniversaire de Gnassingbé. À Lomé, les habitants ont organisé des « manifestations bruyantes » symboliques, frappant sur des casseroles et soufflant dans des vuvuzelas pour se faire entendre malgré la forte présence policière. Bien que largement pacifiques, les autorités ont réprimé ces manifestations : les forces de sécurité ont dispersé les rassemblements et arrêté des personnes, dont plusieurs ont par la suite confirmé avoir été torturées pendant leur détention.
Le 26 juin, les manifestations ont repris, mais cette fois-ci, elles étaient beaucoup plus importantes et explicitement politiques. Les manifestants ont dénoncé l’arrestation d’Aamron et le coup d’État constitutionnel de 2024, tout en exprimant leur colère face à la hausse des tarifs de l’électricité et à l’explosion du coût de la vie. L’État a répondu par une répression brutale, tuant au moins sept personnes, dont Jacques Koami Koutoglo, âgé de 15 ans. Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes, frappé les manifestants et procédé à des arrestations massives.
Malgré la répression, les manifestations se sont poursuivies. La population est de nouveau descendue dans la rue à l’approche des élections municipales du 17 juillet, accusant le gouvernement d’organiser un nouveau scrutin truqué avec des résultats prédéterminés et appelant au boycott. Les forces de sécurité sont une nouvelle fois intervenues avec des gaz lacrymogènes et des arrestations. Le gouvernement a encore intensifié la répression en émettant des mandats d’arrêt internationaux contre des dirigeants du M66 basés à l’étranger, les accusant de terrorisme et de subversion. Cela a clairement montré que le gouvernement se sent menacé par un mouvement opérant en dehors du système politique traditionnel et donc plus difficile à contrôler.
En août, le M66 s’était transformé en un mouvement civique plus large. Aux côtés d’organisations telles que le Front Citoyen Togo Debout et Novation Internationale, il a déclaré le 30 août journée de désobéissance civile. Sous le slogan « Togo Mort », ils ont exhorté la population à paralyser la vie quotidienne en signe de protestation.
Un tournant démocratique ?
La pression en faveur d’un changement démocratique au Togo semble atteindre un point de bascule. Les modifications constitutionnelles destinées à maintenir le pouvoir de Gnassingbé ont au contraire galvanisé une opposition sans précédent, cristallisant des décennies de frustrations accumulées.
Le rôle central de la jeunesse, moins intimidée par l’appareil sécuritaire et mieux connectée grâce aux réseaux sociaux, a diversifié les tactiques de l’opposition et renforcé la résistance. Les militants alternent désormais entre manifestations de rue, recours juridiques et plaidoyer international, selon les circonstances.
La diaspora joue également un rôle crucial : les communautés togolaises à l’étranger organisent des manifestations de solidarité et plaident auprès des organisations internationales en faveur de sanctions contre le régime de Gnassingbé.
Des obstacles importants subsistent toutefois, car l’appareil sécuritaire reste fidèle à Gnassingbé. Pour qu’une transition démocratique ait lieu, la pression internationale devrait s’intensifier, notamment par l’imposition de sanctions ciblées contre les responsables du régime et leurs intérêts économiques. Les organismes régionaux, notamment la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), devraient agir, notamment en menaçant de suspendre le Togo jusqu’à la mise en œuvre de réformes démocratiques.
Les dernières manifestations ont montré que le contrôle exercé par le régime n’est plus aussi absolu qu’autrefois. Reste à savoir si cela marque le début d’une véritable transition démocratique ou un nouveau chapitre dans la longue histoire de la répression de la dissidence. Tout dépendra de la capacité des forces pro-démocratiques à maintenir la pression. La jeunesse togolaise a découvert le pouvoir de l’action collective, et cela pourrait s’avérer décisif.
NOS APPELS À L’ACTION
-
Le gouvernement togolais doit mettre fin aux détentions arbitraires et rétablir les droits constitutionnels suspendus lors des répressions des manifestations.
-
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest doit imposer des sanctions ciblées aux responsables togolais jusqu’à ce que de véritables réformes démocratiques soient mises en œuvre.
-
Les bailleurs de fonds internationaux doivent mettre en place des mécanismes de financement d’urgence pour soutenir la société civile togolaise et les médias indépendants opérant en exil.
Pour toute demande d’entretien ou pour plus d’informations, veuillez contacter research@civicus.org
Photo de couverture par Pascal.Van, sous licence CC BY-SA 2.0